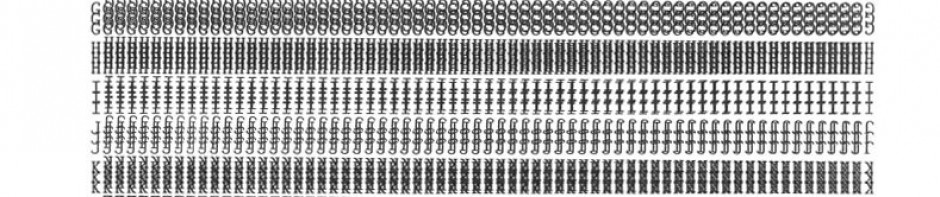La nuit longue.
La solitude.
Contre la porte en bois
Une feuille de paulownia
apportée par le vent,
est tombée…
J’attends quelqu’un dans ce réduit, au clair de lune,
où chante le cri-cri…
Anciennes lettres d’amour,
que je retrouve,
elles contiennent des chansons…
connues ou non, que m’importe!
Pour moi seule.
(notes prises dans ma chambre à coucher)
Poèmes d’une courtisane de Nagasaki, trouvé après le bombardement atomique.
Chaque jour, silencieusement, un peu plus emmurés dans le flot du métro, de la publicité made in télé Sony, de luxe, super de luxe.
Fait l’amour dans un bar. Fait l’amour sur un travesti de la cité Rouge. Toujours tirer sa petite goutte de soleil et bien se reculotter dans ces chambres où les lits branlent électriquement. Films pornos en circuit fermé et lui qui m’a savonné le sexe dans la salle de bains, s’est accroupi pour que je le pénètre.
Dans un grand sac, il enfouit les serviettes, les yukatas, il pratique la récupération. Il me dit qu’il est pauvre, qu’il voudrait aussi une télé et un frigidaire, exploité comme les autres. Ici, pourtant tous les gestes se paient, et cher. La caresse d’une femme contre quatre whiskys. Lui toucher les seins lorsque je paraîtrai ivre, près d’être poliment reconduit vers un taxi.
Il attend
pattes liées grésillant
sur le sol sec
que la pluie vienne
sa mort du moins sera bien verte
Pourquoi m’est-il impossible de t’abandonner, de te planter là dans ce terreau obscur du Japon avec ta solitude pour tuteur et ma défection ? J’ai beau dire que c’est trop lourd, qu’il est grand temps, que je me nourrisse de mon côté, rien ne me vient que l’envie de conjuguer ce nous que nous pourrions être.
Je saigne comme un goret.
Ma vie a les yeux écartelés, dormi dans mes vomissures et les bras de la mama San, si vieille qu’on ne peut plus compter ses rides tant elles sont belles.
Tu dois partir maintenant, en effet, t’ébranler pour le long voyage où tu remonteras vers l’Est, il faudra d’abord que tu aies oublié ton espoir autant que ton désespoir, pour qu’une plus profonde mémoire te saisisse à bras le corps devant ce que tu n’as pas attendu.
Oh! ce cri de veilleur de nuit :
«Prenez garde aux feux!
Prenez garde aux feux!»
J’ai retrouvé tes mots au revers d’un livre échoué à Makabe, le sempiternel «Déchéance d’un homme» qui t’accompagnait sur les bateaux celui dont je n’aime pas regarder les lignes soulignées de ta main, tant j’y trouve d’insistance à garantir le tourment de la déraisonnable raison.
Ici, tout meurt. On a mis sous goutte à goutte les cerisiers du Palais impérial.
Je suis tributaire. Rien, aucune joie, aucune peine ne m’habite vraiment.
Les jours passent. Un long silence. Rien ni personne n’apporte les graines musicales et tendres de notre moulin de vie. En panne, en détresse, en ruine, en attente, en vain.
Hier, Kyôko violée sur la longue plage de Chiba où nous avions l’habitude de traîner et de dormir les nuits de novembre. Feux crispés. Elle, cuisses écartées dans un viol rituel, le puceau du village, puis les hommes valides, avait atteint la mort.
Un jour nous aurons de merveilleux manteaux.
Si tu es au soleil, n’oublie pas la grande, l’Initiale Déesse Amaterasu – ô – mi – kami, la «Grande Déesse de la Lumière céleste». Elle te dénouera de tes noeuds nocturnes, elle te fera sortir de ton double cercle de glace. Tu sais bien que jamais tu ne perdis la grâce : tu cherchais seulement à t’en défaire (et d’autant plus acharnés tes efforts, qu’elle était toujours là, infinie. Et comment briser l’infini?)
Soleil? Lumière? Cette bouillie grise, chaude, aveugle, au dessus de Tokyo ? Vive le PNB, monsieur Eisaku Sato. Mon quartier devient célèbre, on y a trouvé une nouvelle conjonctivite à cause du stationnement trop prolongé des voitures dans la cuvette. Les bronches pètent. Le médecin me dit que j’ai de l’asthme, mais c’est si courant.
La conjonctivite d’Ushigome Yanagi Cho, la vache du saule pleureur!
Lu «Tamura Ryuichi» :
ne mettez pas mon cadavre en terre
votre mort
ne peut se reposer sur la terre
mettez mon cadavre
dans un cercueil vertical
dressez-le!
Sur la terre il n’y a pas notre tombeau
sur la terre il n’y a pas de tombeau
pour y mettre mon cadavre
je connais la mort de la terre
je connais le sens de la mort de la terre
n’importe où
votre mort n’a jamais été mise au tombeau
le cadavre d’une petite fille qui coule dans une rivière
le sang d’un oiseau tué et
beaucoup de voix massacrées
sont chassés par votre terre
et deviennent apatrides comme vous
sur la terre nous n’avons pas de pays
sur la terre il n’y a pas de pays
raisonnable à notre mort
je connais la valeur de la terre
je connais la valeur perdue de la terre
n’importe où
votre vie ne fut jamais pleine du grandiose
le blé récolté pour le futur même
les bêtes mises en proie et les soeurs petites
sont chassées de votre vie
et deviennent apatrides
sur la terre nous n’avons pas de pays
sur la terre il n’y a pas de pays valable
pour notre vie
Mais qu’il en soit fini de ce temps où la douleur reprend ses terres, quoiqu’on fasse.
Quelle lente progression, ce chemin souvent douloureux où mon orgueil, la race peut-être, se sent écrasé, parfois subtilement humilié. L’inconscience dirige tout. Que faire d’autre ? A quoi sert la révolte ? Un chant de cygne, notre monde le prend pour un luxe, une verrue qui doit disparaître. Accepter tous niveaux, jeux, même pour les causes nobles qui ainsi accouchées ont l’allure de foetus acéphales. Que serai-je au bout de ces modifications de cloportes ? A force de descendre on ne peut remonter qu’au royaume des caves.
Humidité confondue avec chaleur.
Mais rompre, déchirer ce tissu, le pouvoir ? Ma voix s’enroue, se referme, s’entube dans ma gorge. Le verbe se distend, engrosse, roule, cheval, mer, tertre, merde.
Temporalité décrochée, maintenant il est exactement, exactement, exactement, alors nager, chien noyé pelage arraché, nudité brune et dans les yeux des immortels j’entends la craie qui ronge l’oreille du temps.
Nous sommes arbres blessés, non coupés, et peut-être blessés seulement pour une ascension plus haute.
J’irai mourir comme un chien
sur les grands boulevards et peu importe qu’il se fasse tard le vent à toujours le goût des larmes.
Il ne restera rien de nos songes ignobles. Ta mort, tu vas la caresser, chevelure enlevée à la lucidité, à l’épargne des mots, me blesser ? Connais-tu l’étrangeté des voûtures, cristaux collés à mes veines. Il pouvait s’offrir à toute tendresse, les heures reconnues, la tige folle d’une fleur de papier repoussé par l’air conditionné. A côté de moi, il te faudrait plus de mémoire, trouver cette chair débitable aux vers. Ici, où tout se résout en diarrhée verbale.
L’ordre triomphera, petit enfant lucide, l’ordre t’attend en robe et brandebourgs, les mots ne sont que des attrape-silence. Je me souviens, vieux marchand de farces. Que faisait ce drap sanglant à la fenêtre ? Le drapeau japonais ne représente pas le soleil, mais les menstrues de la vieille déesse fécondante.
Moi et ma tonsure mentale
qui m’a rasé de si près ?
Qui dira le poids de la vulnérabilité ?
Pour dormir à l’époque tu suçais le long lobe de l’oreille de ton grand-père.
Il fait froid en moi, il neige, comme si j’étais le dernier homme, je n’ai plus à errer, les buts et les chemins clos. J’ai franchi les trois marches d’un très vieux sanctuaires dont le Torii moussu laissait encore poindre trois têtes, crêtes rasées de coq lunaires.
Il faudrait m’arrêter, mais je n’ai en mes mains que du sel pour te refaire. Lourd, ce sac craquelé en son centre. Je sais depuis ma marche, mais quand donc cela commença, mais je le porte depuis, non, ce n’est pas un rêve par le poids et la tassure de mes épaules. Je devrais m’arrêter car le vent me pousse et m’éloigne de ce depuis. Pourquoi porter du sel, un sac de jute, je ne le connais pas. Cette douleur dans les vertèbres. Donc il y aurait longtemps. Du sel alors même que je marche sur le dos de la mer. Je comprends que le temps se disloque, dis-loques, rattraper ce depuis, tout le problème est de passer ce sac j’avais un mot incertain, l’écho s’assombrissait. Il claquait ma langue sur la mâchoire supérieure, puis rentrait ma langue inférieure pour siffler comme le vent, mais l’écho le ternissait de buée roide. Je suis tombé, une mauvaise racine de pin j’ai vu le sac.
Moi, je ne construis pas les signes mais je les drague avec toute ma peine.
«Le Yô-tchan que nous avons connu était profondément candide ; avec de l’attention s’il n’avait pas bu de saké… mais non! Même quand il buvait, c’était un bon enfant pareil à Dieu.»
(«la déchéance d’un homme Dazaï Osamu)
Minata Kenji.
Ce texte fait partie d’une série de documents rares et peu connus sur l’armée rouge japonaise, qui avaient été publiés dans feue la revue Le Fou parle n°3 en 1977
«Signé Kenji Minata, (il) m’avait été confié par un jeune homme maigre, aux yeux tristes, que j’avais rencontré au Fugetsudo, café de Tokyo où passaient tous les «voyageurs» débarquant du Népal, d’Afghanistan et qui se mêlaient aux marginaux japonais. Nous étions en novembre 1970 et la société japonaise me paraissait imprégnée de désespoir. Les gens couraient dans les rues du quartier de Shinjuku comme des rats sous une cloche à fromage, vide. Le même étouffement dû au ciel, peut-être. J’ai rapporté ce texte à la revue pour laquelle je travaillais à Honk-Kong. Elle l’a refusé. Kenji Minata est mort d’une overdose de benzine qu’il inhalait en la mettant dans un sac en plastique, certainement fabriquée par le trust Mitsubishi. La « brutalité » de la société au plus haut développement technologique en Asie l’a tué. Son texte contenait trop de violence pour vivre.»
So Tei Sen